La souffrance individuelle (et collective) est-elle un critère politique ?
Catégorie :
Thèmes :
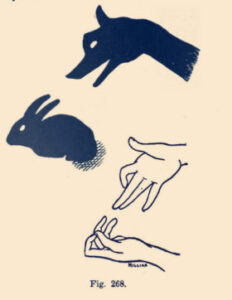
Dans ce texte, j’entends explorer un paradoxe majeur des politiques de l’identité (identity politics) contemporaines : pourquoi cherchons-nous la reconnaissance de la part des mêmes institutions que nous rejetons en tant qu’elles sont oppressives ? J’affirme que les attaques continues du néolibéralisme sur les bases de la collectivité ont mené à suspecter le concept du « collectif » d’être une contrainte essentialiste.
À partir de la théorisation du « colportage de la souffrance » (suffer-mongering) par Wendy Brown, comme caractéristique des politiques de l’identité, je soutiens l’hypothèse selon laquelle les attaques contre le collectif, couplées à l’impératif néolibéral de confession et de création d’un soi « authentique », a conduit à ce que le trauma et la condition de victime deviennent les seules bases sur lesquelles peuvent s’unir les gens.
Je vais montrer la manière dont cela se manifeste, de façon discursive, dans le premier trope des politiques de l’identité contemporaines : l’ « l’intersectionnalité ».
La mobilisation autour de ce concept analytique a mené à une analyse de l’oppression qui, bien qu’elle prétende être systémique, est totalement dématérialisée et continuellement individualisée.
Parce que ce langage présente l’injustice systémique à travers ses effets sur les individus, je soutiens l’idée qu’il y a un élan moralisateur dans ce discours qui mène à un rejet du pouvoir.
Au lieu de nous mobiliser pour bâtir un pouvoir collectif, nous nous retrouvons avec une politique de la revendication individuelle, venant d’un ensemble de positions subjectives dispersées.
Ainsi, alors qu’il y a un refus de se confronter aux structures institutionnelles de la part des militants « radicaux », la démobilisation et la réification égocentrée de la condition de victime n’offrent aucune perspective cohérente pour créer un futur désirable, au-delà de la reconnaissance universelle de la souffrance.
Non seulement cela réoriente le sujet vers la logique du néolibéralisme comme étant, d’une manière ou d’une autre, incontestable, mais cela réduit effectivement la résistance à des revendications adressées aux mêmes institutions rejetées.
Je conclurai en suggérant des moyens d’aller au-delà du conservatisme unilatéral de la reconnaissance de la condition de victime et de retrouver l’importance de la construction du collectif comme effort créatif d’agentivité (agency) humaine.
- Introduction
Les politiques de l’identité sont passées au premier plan, devenant le principal cheval de bataille de la politique de gauche contemporaine. Toutefois, ce que l’on entend par « politiques de l’identité » n’est que rarement défini et est politiquement controversé. Je soutiens l’idée que les significations et les usages des politiques de l’identité découlent de l’ère des Nouveaux Mouvements Sociaux (NMS), ce qui a engendré une confusion théorique sur ce que l’on comprend par l’organisation basée sur l’identité. D’une part, le concept de « politiques de l’identité » a été mis dans le même sac que l’essentialisme, le particularisme et le déterminisme culturel1. Cela peut être vu comme un constat des échecs des mouvements des politiques de l’identité à prêter attention aux différences intragroupes, reproduisant donc, à leur insu, les structures de domination au sein des mouvements eux-mêmes. D’autre part, l’identité comme « expérience » est devenue l’épreuve de vérité communément admise pour se légitimer politiquement dans les cercles militants ; c’est une assertion généralement acceptée au sein de la gauche que les opprimés ont une meilleure compréhension de la réalité, puisque celle-ci se base sur leurs identités, sur leur expérience de l’oppression. Paradoxalement, la prévalence simultanée de ces deux assertions apparemment opposées a résulté en un terrain confus, où les « politiques de l’identité » se trouvent bafouées bien que la centralité politique de l’identité soit affirmée.
Un moment qui fait ressortir les contradictions et tensions sur le terrain actuel des politiques de l’identité est la confrontation entre des militants de Black Lives Matter (BLM) et Hillary Clinton, pendant la campagne de candidature de Clinton aux primaires démocrates. L’incident, qui s’est déroulé au New Hampshire, a mené à une conversation entre les deux militants de BLM et Clinton. Les militants ont reproché à Clinton son rôle dans les politiques d’incarcération de masse et dans la guerre contre les drogues, souhaitant la rendre responsable des dommages causés aux communautés noires. Daunasia Yancey, l’une des deux membres de BLM, a décrit leur objectif comme la recherche d’une « réflexion personnelle sur sa responsabilité quant à son rôle dans les causes de ce problème2. » Ce moment a été filmé et s’est rapidement répandu largement sur le net. Les questions posées par les militants de BLM, tout comme le cadre de l’incident dans son ensemble, mettent en avant nombre des tensions que je souhaite explorer. Prenons, en particulier, les déclarations suivantes :
Question : « qu’est-ce qui, dans votre cœur, a changé, qui va changer la direction de ce pays (…) Que ressentez-vous réellement, qui soit différent par rapport à ce que vous ressentiez avant [l’auteure souligne] ?
Question « (…) vous ne dites pas aux noirs ce que nous avons besoin d’entendre. Et nous n’allons pas vous dire tout ce que vous avez à faire. »
Hillary Clinton : « Je ne vous dis pas cela — je vous demande simplement de me dire. »
Question : « Ce que je veux dire c’est — c’est et cela a toujours été un problème blanc de violence. Ce n’est pas — il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire pour arrêter la violence qui s’exerce contre nous3. »
Dans cet échange, il apparaît clairement que les militants de BLM souhaitent se dissocier des politiques institutionnelles. Lorsque Hillary Clinton leur demande quelle politique ils souhaitent voir appliquer, les militants BLM réfutent la question : « nous n’allons pas vous dire tout ce que vous avez à faire. » Ils ne pensent clairement pas que leur rôle soit de proposer des solutions institutionnelles, et ils souhaitent se mettre à distance du « problème blanc de violence ». Cet exemple illustre une tendance actuelle dans les politiques de gauche, qui veut dissocier et mettre à distance les sujets opprimés du pouvoir et des institutions. Paradoxalement, le pouvoir des opprimés est considéré comme découlant de cette abjection. Cela mène à un modèle de résistance méfiant envers le fait de s’organiser autour d’un objectif et qui se base plutôt sur des moments de rupture qui perturbent le régime existant. Cela dessine les contours d’une conception de l’identité comme étant imposée à un sujet en tant que marque de pouvoir, et d’une conception de l’impuissance comme vertu politique.
Néanmoins, cette conception de l’identité est incompatible avec le second courant théorique des politiques de l’identité, qui met en avant les récits affectifs et expérientiels de l’oppression. Les militants de BLM demandant à Clinton de chercher dans son cœur et d’exprimer ses sentiments sont un exemple de la manière dont la dimension psychique de la reconnaissance imprègne le langage de la gauche. Coexistant avec le rejet de la politique institutionnel et la distanciation de l’oppression vis-à-vis du pouvoir, cette tendance considère que l’opprimé cherche la reconnaissance affective des institutions et de ceux qui sont en position de pouvoir. Il est notoire que les questions des membres de BLM adressées à Clinton situent leur intervention dans un registre interpersonnel. Cette dimension des mouvements de résistance recherche la reconnaissance et la visibilité de leur identité spécifique, mais en outre, cette identité est formulée en termes affectifs. Ce que l’on prétend particulièrement rendre visible, ce sont les identités de l’opprimé et de l’oppresseur. Tandis que les militants BLM s’abstiennent de suggérer des politiques spécifiques ou même des objectifs à Clinton, ils demandent plutôt une « réflexion » : « comment ces erreurs que vous avez commises peuvent-elles servir de leçons à l’ensemble de l’Amérique comme moment de réflexion sur la manière dont les noirs sont traités dans ce pays4 ? » La supposition sous-jacente dans ce cas est que rendre l’oppression visible va, d’une manière ou d’une autre, l’atténuer. Cela s’ancre dans un modèle de politique propre à la « culture du call out », dans laquelle la meilleure réponse aux attitudes oppressives est de contester les gens à partir de leur positionnement et de leur manque de connaissance de l’expérience des autres. On se concentre sur l’analyse des dynamiques interpersonnelles et des effets quotidiens vécus des systèmes d’oppression.
Dans cet article, je vais d’abord brièvement examiner la logique et les implications de l’avènement du néolibéralisme. Je vais montrer que les pressions exercées par l’individualisation produite par le néolibéralisme ont engendré un climat politique dans lequel la revendication de l’émancipation sonne comme une demande de déstigmatisation et de visibilisation des identités opprimées. Nous explorerons cela à travers le prisme de « l’intersectionnalité », en tant que nouveau visage des politiques de l’identité. L’atomisation de la lutte politique et les pressions exercées sur notre appréhension de l’action collective ont bâti un espace où la prévalence du trauma individuel devient la seule manière de concevoir ce que l’on a en commun. Afin d’aller au-delà de cela, il est nécessaire de ressusciter la saillance politique du collectif comme construction intentionnelle. De cette manière, nous pouvons à nouveau concevoir la solidarité collective comme un produit de l’agentivité humaine en opposition à la solidarité produite de fait par les structures de domination.
I
L’économie politique du néolibéralisme se fonde sur l’économie d’un marché radicalement libre selon l’école de Chicago. Celle-ci a été décrite comme la colonisation de tous les aspects de la vie par les valeurs marchandes ; en cela, elle présuppose que la logique du capital est déjà universelle5. Le libéralisme classique supposait une certaine logique naturelle dans l’économie capitaliste, considérant l’émergence du marché comme spontanée, basée sur la tendance naturelle au « commerce, au troc et à l’échange6 ». Il se préoccupait assez largement des limites dans le contexte de « lois naturelles » ; « lois naturelles qui font de l’homme ce qu’il est “naturellement” et qui doivent servir de limites à l’activité de l’État ; les lois économiques, tout aussi “’naturelles”’, qui doivent circonscrire et réguler les décisions politiques7 ». Ainsi, dans le libéralisme classique, il existait un fossé entre la société civile et l’économie, selon lequel les valeurs d’égalité et de liberté fonctionnaient de manière antagonique ; on peut voir cela dans les critiques hétérogènes et les tendances divergentes du libéralisme au XIXe siècle.
L’émergence ultime du néolibéralisme, selon Dardot et Laval, a découlé d’une crise de la gouvernementalité libérale qui était inapte à faire face, sans changer de forme, aux changements organisationnels du capitalisme. C’était « une crise qui pose essentiellement le problème pratique de l’intervention politique en matière économique et sociale et celui de sa justification doctrinale8 ». La rupture du néolibéralisme d’avec le libéralisme se fait dans le mouvement du passage d’une logique d’échange marchand à celle de la compétition du marché. La conception classique du marché, comme étant basée sur le besoin naturel d’échanger, devient la conception de la concurrence économique, pour laquelle le marché est construit en vue de la garantir9. Cela va bien au-delà de l’économie. La logique du néolibéralisme voit que le capitalisme implique des flux économiques permanents, sous-tendus par la concurrence ; cela requiert une adaptation de la nature humaine. Cela nécessite une internalisation au niveau individuel comme au niveau collectif de la concurrence et de l’entreprise comme modèle de comportement : « la rationalité néolibérale pousse le moi à agir sur lui-même dans le sens de son propre renforcement pour survivre dans la compétition10 ».
En tant que tel, le néolibéralisme ne peut simplement être entendu comme économie politique, mais comme un type de société et un mode de gouvernance. Si l’on suit le concept foucaldien de « gouvernementalité » comme « la conduite des conduites », ou le fait de gouverner la conduite du peuple à travers les appareils d’État, le néolibéralisme a cherché à transformer la subjectivité11. Il a engendré de nouveaux rapports avec le moi, tout en reconfigurant, simultanément, la forme du capitalisme. Loin de représenter un retrait de l’État, ou la colonisation de l’État par le marché, le néolibéralisme fonctionne à travers une stratégie d’État qui cherche à produire des sujets égoïstes, de créer des sujets orientés vers le marché. Comme le note Lemke, le néolibéralisme construit intentionnellement l’économie même dont il suppose idéologiquement qu’elle existe déjà, favorisant les rapports de concurrence tout en faisant de la compétition la base des rapports sociaux12.
Le néolibéralisme cherche à combler le fossé entre « les principes moraux et politiques d’un côté et les principes économiques de l’autre13 ». Il vise à placer une valeur morale au-dessus des rapports économiques ; la concurrence n’est pas seulement une nécessité économique, mais un impératif moral. Les liens sociaux et les sécurités collectives sont perçus comme des entraves à la concurrence, et la protection sociale s’avère destructrice pour les valeurs dont le capitalisme a désormais besoin pour fonctionner. En tant que tel, le néolibéralisme remet en question « toutes les structures collectives capables de faire obstacle à la logique du marché pur14 ». C’est là le fond sur lequel repose l’atomisation de la force de travail et les attaques contre les syndicats et tout autre obstacle à la concurrence individuelle. L’économie post-fordiste, avec son insistance sur la flexibilité, la multiplicité des tâches, la sous-traitance, etc., est étayée par le démantèlement de l’État providence et l’impératif moral à travailler qui l’accompagne. La privatisation des ressources collectives est combinée avec une attaque moralisante, idéologique, sur la protection garantie par l’État, qui fait de la sécurité une barrière à l’auto-organisation, à l’innovation et à la création de richesse.
Dans le même temps, le réseau de structures du capitalisme post-fordiste a pour conséquence l’internalisation du contrôle chez les employés, réclamant toujours plus d’auto-perfectionnement en tant qu’auto-investissement. La refonte du sujet en tant que sujet de l’entreprise, l’entrepreneur universel, vise à briser la distinction entre le capitaliste et l’ouvrier, entre l’homme d’affaires et le citoyen. Les ouvriers sont désignés comme du « capital humain » et se possèdent eux-mêmes en tant qu’actifs, chacun étant responsable de sa propre valeur. Ceci est englobé dans le concept de « compétence », qui confond les qualités d’une personne avec sa force de travail15. Des mesures comme l’individualisation de la routine des ouvriers et l’utilisation de la rémunération au rendement de la part des employeurs constituent une attaque contre le collectivisme des syndicats qui ont, historiquement, amélioré les conditions collectives, et traitent chaque ouvrier comme un sous-traitant.
Appréhender le néolibéralisme comme une rationalité qui structure la formation du sujet est essentiel pour comprendre la manière actuelle dont est mobilisée l’identité, ainsi que les effets dépolitisants de la corrélation fortuite entre la logique des politiques de l’identité contemporaines et les techniques néolibérales de gouvernementalité. Le néolibéralisme constitue une attaque contre la solidarité collective, transformant les bases économiques, politiques et culturelles sur lesquelles le peuple s’unit. Ce faisant, il personnalise les causes de la souffrance en trauma individuel, qui peut à son tour être géré16. La personnalisation du travail et des attaques politiques contre les syndicats est une atteinte aux bases économiques de l’action collective, tandis que l’accent mis sur la marchandisation de soi-même et l’importance d’une identité unique, authentique et individuelle affaiblit les fondations de la compréhension de l’expérience collective.
J’affirme que le néolibéralisme, dans sa tentative de détruire la base de la collectivité, fournit la base sur laquelle les mouvements privilégient l’individualité. On trouve, reflétée dans la théorie et dans la pratique des politiques de l’identité contemporaines, une dépolitisation de la lutte, présentant l’oppression comme subjective et individuelle. Le tournant discursif adopté par le langage de la politique de l’identité évince les hypothèses mouvantes concernant les limites du possible. En termes généraux, le premier tournant a été celui d’un langage qui exprime des questions collectives et structurelles, à un langage privilégiant des comportements individuels et mettant en avant la différence. Bien que le caractère « systémique » de l’oppression soit souligné, la focale est mise sur les effets de l’oppression. Cette approche se différencie d’une analyse des raisons pour lesquelles des systèmes comme le racisme et le patriarcat existent. Le problème de cette lecture réside dans le fait que se focaliser sur les victimes de la non-reconnaissance éclipse souvent les raisons de cette non-reconnaissance17. Tout cela se déroule dans un contexte qui valorise la vulnérabilité, situant les identités au sein d’un registre moral. Il tente de fusionner la souffrance dans un programme politique, tout en encourageant une politique de la culpabilité qui place l’auto-flagellation et la transformation au même niveau.
II
Si la rationalité néolibérale nourrit une obsession avec le soi, cela se reflète dans la direction adoptée par les politiques de l’identité contemporaine. Les tournants dans la façon dont sont utilisées les « politiques de l’identité » reflètent les défaillances perceptibles dans les politiques collectives. Les politiques de l’identité ont d’abord défini les mouvements pour l’émancipation de groupes spécifiques sur la base d’une identité sociale opprimée. Dans la seconde moitié du vingtième siècle, les mouvements pour la libération des femmes, LGBT et pour les droits civils des noirs se sont tous mobilisés sur la base d’injustices spécifiques propres à leurs groupes. Selon Nancy Fraser, cela a marqué un tournant dans la « grammaire de l’élaboration des revendications politiques », de l’économique au culturel18. Néanmoins, les origines des politiques de l’identité ne s’opposaient pas au socialisme. En effet, ces groupes de la nouvelle gauche ont été créés en réponse au réductionnisme de classe grossier de l’ancienne gauche, mais se sont formés au sein de la tradition de l’organisation socialiste. Ils ont simplement refusé de voir dans l’ouvrier blanc le sujet universel et sa condition comme étant universelle.
Cette politisation de l’identité était une réponse aux conséquences matérielles de sa formation historique, et à son imposition qui découlait de l’exploitation et de l’assujettissement. Les groupes de libération noire ont lutté « contre l’aliénation et l’unilatéralité de la négritude (blackness) », tandis que les groupes de libération des femmes « luttaient pour leur émancipation reproductive et sexuelle, afin de prendre le contrôle des moyens de production (leurs corps)19 ». Ici, l’identité était traitée comme un rapport politique. Toutefois, l’exclusion fréquente des femmes noires de ces mouvements a montré la tendance à essentialiser une expérience particulière de la négritude ou de la condition des femmes (womanhood) posant les intérêts des hommes noirs et des femmes blanches comme constitutifs des identités des « noirs » et des « femmes ». Les féministes noires se sont organisées en réponse à ces antagonismes et à leur « perspective unidimensionnelle » souvent prise comme totalité. L’éminente militante et chercheuse bell hooks écrit que « les femmes blanches qui dominent le discours féministe d’aujourd’hui se demandent rarement si, oui ou non, leur perspective sur la réalité des femmes correspond aux expériences vécues des femmes en tant que groupe collectif. Elles ne sont pas non plus conscientes du point jusque auquel leurs perspectives reflètent des biais de race et de classe20 ». Elle pointe l’erreur que constitue la comparaison entre l’oppression du peuple noir et l’oppression des femmes : « Cela implique que toutes les femmes sont blanches et que tous les noirs sont des hommes21 ».
En fait, le néologisme particulier des « politiques de l’identité » est attribué au Combahee River Collective (CRC), un groupe de féministes noires des années 197022. Elles les définissent de la manière suivante : « Cette concentration sur notre propre oppression s’incarne dans le concept de politiques de l’identité. Nous croyons que la politique la plus approfondie, et potentiellement la plus radicale, vient directement de notre identité, en opposition avec le travail effectué pour mettre fin à l’oppression de quelqu’un d’autre23 ». Toutefois, le CRC n’entendait pas défendre une politique séparatiste, mais peut être compris comme s’inscrivant dans la logique d’émancipation universelle dans le contexte de la lutte anti-impérialiste. La vague de mouvements anticoloniaux dans le Tiers-Monde et l’influence de penseurs non-occidentaux ont profondément influencé la compréhension socialiste de l’internationalisme et des rapports entre les formes particulières d’oppression et l’émancipation universelle, tels que reflétés dans le sentiment qu’« en luttant pour les intérêts de notre peuple, nous luttons également pour ceux des peuples du monde entier24 ». Cette logique sous-tendait l’itération des politiques de l’identité du CRC, qui se comprenait comme luttant pour la libération à partir des systèmes particuliers qui niaient leur véritable potentiel en tant qu’êtres humains : « Nous réalisons que la libération de tous les peuples opprimés nécessite la destruction des systèmes politico-économiques du capitalisme et de l’impérialisme, tout comme de celui du patriarcat25 ».
Aujourd’hui, ce cadre théorique est souvent considéré comme constituant les racines de l’« intersectionnalité ». Les politiques de l’identité intersectionnelles constituent une réponse au réductionnisme de la soi-disant « question unique » des mouvements des politiques de l’identité, qui excluent les complexités des oppressions et identités multiples. Cela se situe le plus souvent à l’intersection de la race et du genre, et de l’exclusion des femmes noires des cadres antiracistes et féministes. Néanmoins, ce serait une erreur de présumer que les cadres contemporains sont historiquement cohérents. Bien que le concept d’intersectionnalité partage clairement des racines avec l’approche incarnée par le CRC, celui-ci a évolué en un ensemble de politiques qui, de bien des manières importantes, divergent des politiques pratiquées par le CRC et les militants invoqués comme les ancêtres de l’intersectionnalité.
Je pose l’hypothèse selon laquelle les politiques de l’identité contemporaines s’organisent autour de la reconnaissance et des dynamiques interpersonnelles d’oppression, telles qu’elles s’incarnent dans le cadre de l’« intersectionnalité ». En tant que telle, l’identité a été reliée au discours de l’authenticité et s’est éloignée des bases matérielles sur lesquelles elle s’est formée. En cessant de se pencher sur les racines des oppressions particulières, les politiques de l’identité sont devenues une fin en soi, dans lesquelles ce qui est recherché est l’affirmation d’identités dénigrées. Cela a permis aux éléments du discours des politiques de l’identité de se populariser en rencontrant la rationalité néolibérale. L’intersectionnalité est devenue le cadre dominant à travers lequel l’identité est imaginée, non seulement dans les cercles militants, mais également dans les ONG et les institutions gouvernementales26. Ainsi, alors que, en surface, le discours de l’intersectionnalité est lu comme un rejet des conceptions uniformes et essentialistes de l’identité, en pratique celui-ci a multiplié les identités sans s’attaquer à l’essentialisme des catégories identitaires. En tant que tel, le cadre intersectionnel met au centre de son propos l’affirmation de l’identité sans remettre en question ce qui est affirmé.
III
Le terme « intersectionnalité » a d’abord été utilisé par la juriste Kimberlé Crenshaw, qui l’a forgé afin de décrire une discrimination spécifique à laquelle devaient faire face les femmes noires dans le droit du travail. Les femmes noires n’étaient pas aidées par la législation anti-discrimination conçue pour protéger les personnes noires ni par la législation censée protéger les femmes. Elle décrit des études de cas de femmes noires dont les expériences sont constamment reléguées aux marges. Le texte de Crenshaw a très largement influencé la direction prise par la nouvelle itération des politiques de l’identité. Alors que l’intersectionnalité était censée être une critique des politiques de l’identité, elle n’avait pas pour objectif de troubler la politisation de l’identité ; c’est bien plutôt les formations simplistes des catégories identitaires qui doivent être contestées. Elle affirme que « [l]e problème des politiques de l’identité n’est pas qu’elles échouent à transcender la différence (…), mais plutôt le contraire — elles amalgament ou ignorent les différences intragroupes27 ».
Cette reconnaissance de la différence est indubitablement légitime. Les personnes noires ne sont jamais simplement « noires » et les femmes ne sont jamais simplement des « femmes ». Le prisme de l’intersectionnalité offre une manière de percevoir les identités sociales comme des processus de constitution mutuelle qui n’existent pas indépendamment l’une de l’autre. Le problème de la conception de Crenshaw cependant, est qu’elle n’a aucun moyen d’expliquer l’existence des oppressions. La discrimination apparaît simplement comme touchant des groupes particuliers d’individus. Ce point est assez évident dans sa célèbre métaphore du trafic routier pour expliquer l’intersection des oppressions :
La discrimination, comme le trafic à une intersection, peut circuler dans une direction, comme dans une autre. S’il y a un accident à une intersection, celui-ci peut être causé par des voitures venant de différentes directions et, parfois, de toutes les directions. De la même manière, si une femme noire est lésée parce qu’elle se trouve à l’intersection, son préjudice peut découler de la discrimination sexuelle comme de la discrimination raciale28.
Il semblerait, selon cette métaphore, que les femmes noires soient simplement prises dans des discriminations de genre et de race : l’identité apparaît comme une imposition de pouvoir, puisque les questions de subjectivité sont secondaires. Les identités sont déshistoricisées et naturalisées, les catégories identitaires de « femmes » et de « noir » apparaissant comme des traits fortuits, comme la couleur des cheveux ou des yeux. Crenshaw défend « le besoin de rendre compte des multiples bases de l’identité lorsque l’on considère la manière dont le monde social est construit », en concevant l’identité comme quelque chose qui préexiste à la construction du monde social29.
La conception de l’identité qui prévaut dans le discours de l’intersectionnalité aujourd’hui a pratiquement rompu la connexion matérielle entre les catégories identitaires et les moyens de production capitalistes. L’intersectionnalité, comme intersections structurelles des inégalités, souligne « la multiplicité infinie des lieux sociaux substantifs génère une longue liste d’importants points intersectionnels à étudier et offre une tribune aux perspectives de nombreux groupes marginalisés30. » Il y a une focalisation discursive sur les multiples différences entre groupes, mais ce cadre n’exige aucune analyse des systèmes d’exclusion au-delà de leur qualification. Ainsi, la tendance du discours intersectionnel est de situer l’identité en termes purement culturels, écrasant les différentes fonctions de la race, de la classe et du genre de telle manière à ce qu’elles apparaissent comme des descripteurs statiques et intemporels de l’identité, plutôt que comme des catégories dynamiques qui sont activement façonnées par l’oppression et les besoins du capital. Sans cela, l’identité et l’oppression ne peuvent apparaître que comme des discriminations interpersonnelles ; s’il n’y a pas de schéma explicatif pour dire pourquoi le racisme et le sexisme servent des fonctions particulières, ceux-ci ne peuvent qu’être pathologisés en tant que caractéristiques indésirables.
J’affirme que le discours de « l’intersectionnalité » reflète les tensions théoriques de la conception actuelle des politiques de l’identité. Tous deux conçoivent l’identité comme une imposition sur le sujet, comme une marque de pouvoir, et s’inscrivent dans une conception de l’impuissance comme vertu politique, cherchant la reconnaissance sur la base des identités imposées et essentialisées. Cette appréhension s’enracine dans une prise de distance vis-à-vis de la compréhension de l’émancipation universelle qui reste manifeste dans la politique de l’identité du CRC, coïncidant avec l’essor néolibéral de la concurrence individuelle. On peut le constater dans l’analogie du sous-sol de Crenshaw. Dans cet exemple, elle imagine un sous-sol dans lequel toutes les personnes désavantagées sont confinées. Les personnes les plus désavantagées sont au sol, tandis que celles qui le sont moins sont superposées sur ces derniers, « les pieds sur leurs épaules », jusqu’à celles qui ne sont désavantagées que par un seul facteur et qui effleurent le plafond. Au-dessus du plafond, à l’étage supérieur, on trouve les personnes qui ne sont pas désavantagées. Cette métaphore introduit une conception additive de l’oppression, selon laquelle les oppressions sont « superposées ». Dans l’analogie de Crenshaw, ceux qui sont au-dessus, les moins désavantagés, peuvent se faufiler jusqu’à l’étage supérieur, par le plafond, « grâce à la singularité de leur fardeau et de leur position par ailleurs privilégiée31 ». Cela revient à concevoir le pouvoir comme fonctionnant à travers des discriminations interchangeables et interpersonnelles, qui peuvent se cumuler les unes sur les autres. Toutefois, les pouvoirs sociaux diffèrent dans leur forme comme dans leur fonction. Ils ne sont pas juste oppressifs, mais également producteurs de sujets « par des histoires complexes, et souvent fragmentées, dans lesquelles de multiples pouvoirs sociaux sont régulés par et contre les uns et les autres32 ».
Concevoir l’oppression comme additive à la manière de Crenshaw conduit également à appréhender les opprimés comme étant en concurrence, se hissant les uns au-dessus des autres pour atteindre le sommet. Les sujets « privilégiés », discriminés singulièrement, sont admis individuellement en se faufilant à travers une trappe ouverte par ceux de l’étage supérieur. En tant que telle, il s’agit-là d’une vision dans laquelle la solidarité entre les opprimés est impossible, car il s’agit d’un rapport de concurrence entre personnes différemment discriminées, que remportent ceux qui ont le plus en commun avec les non-opprimés. Que la structure de discrimination puisse être dépassée par une invitation à se faufiler à travers la trappe ouverte par ceux du dessus réaffirme le pouvoir des structures existantes pour contrôler l’inclusion. C’est-là une politique de la demande qui dépolitise le conflit ; les progrès ne sont pas perçus comme étant gagnés ou pris, mais réclamés et accordés.
IV
On peut replacer cela dans le contexte de la critique que fait Wendy Brown de « l’attachement blessé » des sujets modernes. Brown critique la politique de la souffrance, mobilisant le concept nietzschéen de ressentiment pour affirmer que les gens aujourd’hui ont perdu leur désir de liberté et sont liés à leur oppression. Le ressentiment est le « triomphe du faible en tant que faible », une revanche moralisante des sans-pouvoirs qui cherche à voir la souffrance comme une vertu sociale, et la force et le privilège comme immoraux. Il s’agit du revers de l’objet, renversant la logique de la domination tout en gardant sa logique intacte. Le ressentiment sert une triple fonction : « il produit un affect (rage, droiture) qui submerge la douleur ; il produit un coupable responsable de la douleur ; et il produit un lieu de revanche pour déplacer la douleur (un endroit où infliger la douleur comme la personne souffrante a été blessée)33 ». Les tensions au sein du libéralisme sont responsables du désir de l’identité politisée de restreindre sa propre liberté. Les sujets libéraux, situés et produits par le pouvoir, se voient refuser la compréhension de ce fait par le discours libéral qui déplace la notion de liberté, précédant le « je », qui est antérieur à la socialisation et est libre de s’auto-façonner. Ainsi, le sujet libéral est voué à un échec qu’il cherche à externaliser34.
Brown affirme que la prévalence des identités politisées résulte en partie de la re-naturalisation du capitalisme provenant de la disparition de la critique du capitalisme35. Eva Mitchell explique la manière dont « l’identité » peut être assimilée au travail aliéné, il s’agit d’une expression unilatérale de notre potentiel total en tant qu’êtres humains36. Dans L’idéologie allemande, Marx écrit que la distribution du travail fait entrer chaque personne dans une « sphère d’activité particulière, exclusive, qui leur est imposée et à laquelle il ne peut échapper37 ». Dans le capitalisme consumériste, les productions disciplinaires façonnent et régulent les sujets en classant les comportements sociaux comme positions sociales. Chercher à se libérer sur la base de l’identité réifie et réaffirme donc simplement leur distribution.
Selon Brown, les politiques de l’identité sont, en partie, une manifestation du ressentiment de classe, suivant lequel l’aliénation et le préjudice causés par le capitalisme sont dépolitisés et transformés en marqueurs de différence sociale38. Les causes économiques et politiques de la souffrance sont exprimées à travers un registre culturel. Ainsi, peu importe à quel point la compréhension de l’identité est sophistiquée, politiser l’identité est une erreur métaphysique : l’identité devrait être le point de départ plutôt que l’objet de la formation de collectivités. Selon cette conception, nous devons nous libérer de l’identité. L’identité politisée est une réaction à, et un effet de la domination, ainsi qu’une auto-affirmation qui réinscrit l’impuissance. Brown affirme que le « langage de la reconnaissance devient un langage de la non-liberté (…) l’articulation du langage, dans le contexte du discours libéral et disciplinaire, devient un vecteur de la subordination à travers l’individualisation, la normalisation et la régulation, même si elle aspire à produire de la visibilité et de l’acceptation39 ».
En s’appuyant sur cette critique, et sans nier la blessure et la souffrance qui constituent souvent les effets vécus de l’oppression, je soutiens que le tournant contemporain vers le trauma et la souffrance relève à la fois d’une fonction du néolibéralisme et d’une réaction au néolibéralisme. Le néolibéralisme a œuvré à détruire la base matérielle de l’existence collective et a continuellement individualisé la souffrance. En définissant l’identité à travers la souffrance psychique, ce manque peut être commercialisé par le biais de discours de développement personnel, de résilience et de reconstruction qui marchandisent le soi. Je considère que politiser l’identité en associant le trauma à l’identité relève d’une tentative de fonder une nouvelle base pour la collectivité. On peut le voir dans l’exemple du « classisme » et du concept de privilège, qui révèlent un cadre dans lequel l’analyse systémique est réduite aux affects personnels. Ces discours fonctionnent souvent à travers une réflexion personnelle exigeante sur la propre place de chacun au sein des systèmes d’oppression, se focalisant sur l’expérience vécue individuelle. Parce que les effets de la domination sont personnalisés en termes affectifs, la réification du trauma et de la condition de victime signifie que la lutte de résistance aux symptômes est prioritaire sur l’analyse systémique.
V
L’existence du capital s’appuie sur une confrontation continue entre accumulation et légitimité. Le capitalisme a survécu en partie par l’absorption de sa critique40. L’esprit du capitalisme est l’épine dorsale de l’accumulation, qui limite à la fois l’accumulation légitime et est capable de désarmer la critique potentiellement dangereuse. De bien des manières, le défi radical que constituaient les politiques de l’identité a été désarmé et subsumé sous la valorisation néolibéraliste de la différence individuelle. Sans théorie explicative de l’identité, les identités apparaissent comme déjà constituées, des fac-similés cristallisés de la lutte sociale. Séparées de l’histoire matérielle de l’identité, les politiques de l’identité deviennent complices de la diversification du capitalisme.
C’est ce que montre l’injonction à en finir avec le « classisme » en tant que discrimination contre les membres de la classe ouvrière, une tentative erronée de saisir la manière dont les rapports de domination fonctionnent au travers de la classe. Le « classisme » est un symptôme d’une société capitaliste fondée sur l’exploitation de classe. Se focaliser sur les effets culturels de l’identité mène à une analyse dématérialisée qui ne peut appréhender le système de classes comme étant nécessaire à l’exploitation du travail, plutôt qu’en termes d’identité dénigrée qui doit être libérée. Cela s’ancre dans la logique sociale et politique du néolibéralisme qui traite les forces marchandes du capitalisme comme étant inévitables et incontestables. La prévalence des glissements discursifs vers une explication de l’oppression en termes de préjugés et de stigmates, ce qu’illustre le langage du classisme, s’inscrit dans cette naturalisation. Cela dissocie l’oppression d’une analyse systémique utile reconnaissant la fonction systémique cruciale jouée par l’oppression. En conséquence, cela naturalise les systèmes d’oppression. Le classisme en est l’exemple le plus évident. Selon cette analyse, les pauvres et les membres de la classe ouvrière souffrent à cause de l’attitude des membres des classes moyennes et supérieures envers eux, et non parce qu’ils sont exploités par les modes de production capitalistes. Les inégalités de richesse et de revenus sont imputées aux préjugés : « le classisme est un traitement différencié en raison de la classe sociale ou de la classe sociale perçue. Le classisme est l’oppression systématique des groupes des classes subordonnées pour avantager et renforcer les groupes des classes dominantes. C’est l’assignation systématique des caractéristiques de valeur et de capacité basées sur la classe sociale41 ».
L’organisation Class Action a son propre slogan : « bâtir des ponts pour réduire la fracture de classe », situant la discrimination de classe dans les relations interpersonnelles qui découlent des caractéristiques systémiques des préjugés. Au lieu d’abolir les rapports de classe, le classisme met l’accent sur l’atténuation des effets individuels des rapports de classe, comme « se sentir inférieur aux membres des classes supérieures ». Au lieu d’exiger le démantèlement du système de classes capitaliste, Class Action met l’accent sur la reconnaissance de la souffrance causée par les relations interpersonnelles comme solution à l’inégalité, aplanissant la fonction de la race, de la classe et du genre en les égalisant par le prisme de l’identité descriptive.
Je ne remets pas en question le fait que la souffrance qui marque la vie des sujets opprimés doive jouer un rôle dans la résistance à l’oppression. Toutefois, la tendance au culturalisme dont font preuve les politiques de l’identité contemporaines mène à concevoir la résistance comme tournée vers l’intérieur, vers les symptômes de l’oppression et à un éloignement des causes systémiques. Ce repli sur soi s’incarne dans la popularité de la théorie du privilège. La théorie du privilège est un exemple de la manière dont les inégalités structurelles sont situées dans les positions individuelles des sujets. La conception qu’a Peggy McIntosh du privilège blanc se situe au fondement à la compréhension actuelle. Elle compile une liste de 50 bénéfices quotidiens du privilège blanc : « J’en suis venue à voir le privilège blanc comme un ensemble invisible d’atouts immérités que je peux encaisser chaque jour, mais desquels je demeure inconsciente42 ». Le concept de privilège personnel comme « avantage immérité (…) à cause de la discrimination » est devenu omniprésent dans le discours des politiques de l’identité43. L’expression « Check your privilege » est devenue un cri de ralliement politique, laissant entendre que la résistance doit débuter par la reconnaissance de la position personnelle de chacun au sein du système.
Là encore, les effets systémiques de l’oppression sont considérés comme localisés chez l’individu. Non seulement la politique est individualisée, mais elle repose sur « des manières nouvelles et en apparence progressistes d’axer la politique autour de l’identité blanche44 ». Cela réduit la solidarité avec l’opprimé à une politique de la culpabilité, dans laquelle l’agentivité politique est remplacée par le moralisme et l’auto-dénonciation. Le discours du privilège est orienté vers les affects individuels ; tous les individus sont privilégiés d’une manière ou d’une autre et doivent accepter leurs privilèges : « l’étape suivante est celle de l’auto-réalisation : vous êtes privilégiés. […] Ce que vous devez réaliser est que nous avons tous des privilèges dans une certaine mesure : le privilège blanc, masculin, hétérosexuel, etc.45 ». Sa popularité contemporaine est tout à fait en osmose avec l’individualisme néolibéral qui rend celui-ci compatible avec l’injustice systémique ; en tant que programme d’action, la théorie du privilège met en avant la transformation de soi plutôt que celle du monde, la résistance étant réduite à l’auto-réflexion.
Il ne fait aucun doute que rendre visible ce que le système social invisibilise est important pour s’attaquer aux effets vécus de l’oppression, et s’attaquer aux effets et attitudes individuels est crucial dans le processus de construction du collectif. Toutefois, lorsque la résistance est présentée comme s’inscrivant principalement dans les actions et croyances individuelles, le politique devient intégralement une question d’éthique, ce qui mène à une politique dépolitisée qui cherche la justice à travers les relations interpersonnelles. Les systèmes racistes et patriarcaux sont réduits aux préjugés racistes et aux attitudes sexistes.
VI
Conformément à la multiplication des positions identitaires dans l’exigence de reconnaissance, l’intersectionnalité et le discours du privilège tendent vers une épistémologie de la provenance, une « théorie excessivement subjectiviste de la connaissance » qui considère que la connaissance est spécifique à chaque groupe et dérive de l’expérience. C’est-là une position individualisante : « puisqu’aucune femme ne peut échapper au fait de vivre une pluralité d’identités, une dynamique centrale des politiques de l’identité est de tendre vers des groupes identitaires toujours plus étroits, pour lesquels le terminus logique ne devrait pas simplement être le subjectivisme, mais le solipsisme, puisqu’aucun ensemble d’expériences n’est identique à un autre46 ». Le droit de s’exprimer à propos de certaines choses est lié à l’identité de chacun et ce droit est refusé aux autres non-identiques47. L’expérience des exclus est ainsi privilégiée, celle-ci étant considérée comme une connaissance de l’exclusion systémique. L’amalgame de ces deux logiques nous conduit à présumer de la vérité sur la base de la souffrance. Individualiser cette logique mène à théoriser la manière dont ce qu’un individu peut voir est limité par le système, mais cela reste de la responsabilité de l’individu d’étendre cette reconnaissance. Il n’y a que les gens qui sont invisibles dans le système qui peuvent et doivent montrer la vérité de l’exclusion.
Cela s’incarne dans la phrase, que l’on entend souvent : « ne parle pas de ma propre expérience vécue ». Dans les cercles féministes, on affirme souvent que les hommes ne devraient pas discuter des interprétations que font les femmes de l’oppression des femmes, en se basant sur le fait que les hommes n’en ont jamais fait l’expérience. Un débat sur l’avortement à l’université d’Oxford a, par exemple, été annulé lorsqu’il est apparu que le débat se déroulerait entre deux hommes. La réponse des féministes arguait du fait qu’il était déplacé de permettre à des hommes de parler de l’avortement alors qu’aucun des deux participants n’aurait jamais à envisager d’avorter : « Comme vous pouvez l’imaginer, celles d’entre nous qui ont un utérus étaient terriblement furieuses que ces hommes puissent parler pour nous et sur nous48 ». Ce recours à l’expérience évite la nécessité de créer et de défendre des causes politiques non situationnelles. Il est démodé de professer une position qui découle de la croyance en un universel, mais le fait de dépendre de l’expérience supprime la nécessité du jugement. Sans la capacité à juger, toutefois, c’est la capacité de comprendre l’oppression qui est en jeu. Cette approche indique un basculement dans le solipsisme, du fait que l’on renonce à la possibilité de saisir l’expérience des autres. De plus, l’oppression est confondue avec la lutte contre celle-ci. C’est ce que Chandra Mohanty critique comme la « thèse de l’osmose féministe », qui présuppose que les femmes sont féministes de par leur expérience de femmes49. En effet, il y a de nombreuses femmes qui, malgré le fait qu’elles aient un utérus, ou même vécu un avortement, ne soutiennent pas les droits reproductifs.
La réification des identités opprimées se fourvoie en présumant qu’être opprimé constitue un « en dehors » vis-à-vis du pouvoir. Toutefois, comme le montre Donna Haraway, « il n’y a pas de perspective immédiate selon le point de vue des assujettis50 ». Rendre compte d’une perspective, ce qui présuppose la lucidité du point de vue des opprimés, constitue un renversement de la position qui est critiquée. C’est une réaction contre la présupposition selon laquelle la vision est naturelle, que sa détermination n’est ni située ni universelle. Il s’agit de la position traditionnellement attribuée au mâle blanc « lambda » ; l’universalisation de la perspective du privilégié. Néanmoins, présumer de la vérité à partir de la position de l’opprimé conserve intacte une division entre ce qui peut être vu et vécu et ce qui ne le peut pas ; il existe un « danger réel de romantiser et/ou de s’approprie

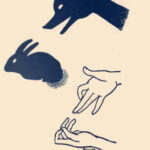
Commentaires
Les commentaires sont modérés a priori.Laisser un commentaire